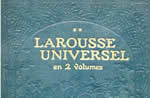Histoire

Les Landes
Nous signalons à nos lecteurs un nouveau volume de M. René Bazin : En Province (Calmann Lévy, éditeur). Sous ce titre, notre distingué collaborateur publie des récits de voyages et des nouvelles. Nos lecteurs savent déjà quel merveilleux conteur est l'auteur des Souvenirs d'enfant et des Contes de bonne Perrette.
Nous empruntons à son dernier ouvrage cette page pittoresque, qui montrera son talent sous un nouveau jour.
Beaucoup de gens ont une idée simple des Landes. J'ai souvent entendu dire : «Les Landes ? Quelle horreur !» Ce qui est moins un jugement qu'une exclamation, une exclamation même qu'une personne avisée ne devrait pas se permettre pour avoir traversé un département au vol d'un train rapide. Car il y a loin d'un paysage aperçu par la portière d'un wagon au même paysage vu et goûté au repos. La beauté, parfois, sort lentement des choses. Et il en est ainsi des Landes.
D'autres, dont les souvenirs se sont immobilisés au temps de Napoléon III ou de Louis-Philippe, n'ont gardé qu'une image d'une excursion lointaine : « Ah! oui, les Landes ! Des pâtres qui vont sur des échasses, – doit-on dire sur, doit-on dire à, doit-on dire en échasses, ô pères du français, pères de l'Académie? – parmi des bruyères roses et mouillées. » Ceux-là ont une opinion un peu moins sommaire que la précédente, mais erronée encore. Ils apprendront que les échasses ont disparu, qu'à peine pourrait-on rencontrer deux ou trois facteurs, des petits pays de marais, faisant encore leur tournée sur ces hauts godillots, et que, si les concours ouverts par la Gironde, en 1892, n'en avaient pas rappelé en service actif quelques paires oubliées, on ne trouverait plus d'échasses qu'aux pieds des oiseaux d'eau, fidèles aux marais de la côte.
D'autres enfin, dont l'impression plus récente n'est pas entièrement fausse, s'imaginent que, depuis les immenses incendies qui ont dévasté la région, on ne marche plus, de Bordeaux jusqu'à Dax, qu'à travers des baliveaux roussis, dans une forêt de poteaux de télégraphe avant l'heure, ayant leurs branches à demi consumées autour d'eux et un peu d'herbe nouvelle à leurs pieds. Cela se voit, en effet, pendant des kilomètres, surtout le long du chemin de fer, parce que les locomotives, en un grand nombre de points, ont mis le feu aux brandes. Mais il est possible de rassurer les amis inquiets, s'il y en a, de la résine, de la colophane et de l'arbre vert. En s'écartant un peu de la route du rapide, on retrouve encore la forêt indéfinie, sombre et houleuse comme l'Océan, et le vent qui chante dans les aiguilles de pin, sous le ciel immense qui met des étincelles aux crêtes mouvantes des arbres.
 |
|
Tous les ans, les plantations de pins maritimes sont éclaircies. Les jeunes arbres abattus font des falourdes pour le chauffage, des allumettes, de la pâte à papier ou des poteaux de mine qu'on expédie en Angleterre. Vers la vingtième année, les pins sont assez forts pour être gemmés. Dans les belles futaies droites, le résinier passe, et marque les victimes qui seront gemmés à mort, c'est-à-dire entaillées profondément, de plusieurs côtés, et qui mourront assez promptement, à bout de larmes. L'expression est très usitée, en terre landaise. On l'emploie même au figuré. Si vous entendiez dire de quelqu'un qu'il est résiné à mort, ne prêtez pas, à moins que vous n'ayez l'intention de donner. Les arbres désignés meurent donc d'épuisement, petit à petit. Les autres, les fûts choisis que l'on veut conserver, sont seulement résinés à vie, et prennent, à l'âge de trente ans, le nom de pins de place. Ils ont le droit de vivre ainsi une trentaine d'années encore. Puis on fait pour eux comme pour les autres déjà disparus et qui leur ont laissé double part d'air et de soleil, on les gemme à mort, et ils deviennent poutres, planches ou soliveaux.
La résine coule en toute saison, pourvu que l'entaille soit fréquemment rafraîchie. Mais celle de printemps est la plus estimée. Le fermier la partage avec le propriétaire, la charge dans des charrettes à larges roues, faites pour rouler sur le sable, et, fouettant ses deux mules, la conduit à l'une des deux cent cinquante ou trois cents petites distilleries établies dans la forêt. Ce qu'elle devient alors, il est difficile de le dire. La belle résine jaune est comme la houille, d'où la chimie tire à peu près ce qu'elle veut. Dans mon enfance, je croyais qu'on la fondait simplement, pour l'appliquer, toute molle, autour d'une mèche et fabriquer ces chandelles primitives que je voyais brûler dans une pince de fer, chez les paysans à la veillée, pauvres bâtons toujours éclatés et fendus, qui pétillaient, fumaient, crachaient leur cire dans l'âtre, et semblaient moins avoir pour mission d'éclairer que d'adoucir la nuit. Aujourd'hui la pince de fer est rouillée sous l'auvent des vieilles cheminées, et l'on m'assure que la résine donne surtout de l'essence de térébenthine, de la colophane pour les violons et les vernis, des huiles d'éclairage, des graisses pour les roues de wagons, une foule de produits encore dont le nom m'échappe. C'est une mine de richesses. Pourtant ceux qui l'exploitent se plaignent de ne vendre la barrique de résine que quarante ou cinquante francs, et il y en qui naïvement regrettent le temps de la guerre de Sécession, qui l'avait fait monter jusqu'au delà de deux cents francs. Oh ! l'histoire vue par ce côté, quelles surprises elle ménage !
Le pays a souffert aussi, et beaucoup souffert, des incendies d'été, les uns allumés par les flammèches des locomotives, les autres par des promeneurs imprudents, d'autres enfin par des bergers qui trouvent que l'herbe venue sous la cendre est excellente aux brebis, et disent sans se faire prier : « Il nous faut la lande toute rase, depuis Bordeaux jusqu'à Dax. » La forêt, vous le voyez, a ses anarchistes. Elle brûle avec une effrayante rapidité. En peu de jours, dernièrement, la flamme a parcouru vingt kilomètres, aux environs de Morcenx, et plus de cinq mille hectares de bois sont là, tout roussis, lugubres, attendant la hache. Le tronc du pin, les branches même très souvent, ne sont pas consumés. Le feu dévore la brousse, les bruyères, les herbes sèches, les feuilles de l'arbre et l'amas de résine que contient l'entaille, à un mètre du sol, et qui flambe, comme un point rouge multiplié à l'infini, longtemps après que la fumée a cessé de s'élever de la terre et que l'incendie s'est éteint ou éloigné. Si l'on ne tarde pas trop à abattre les troncs de pins, ils peuvent encore être utilisés. Mais les gemmiers ont dû fuir, les maisons sont détruites, les pauvres champs de seigle et de millet des clairières n'ont plus un chaume debout. Le pâtre seul y revient, précédent son troupeau et suivant son rêve, qui, hélas ! n'est peut-être pas autre que celui-ci : errer en souverain maître et reprendre sur la forêt les pâturages anciens.
La région au-dessous de Dax; de Saint-Sever et de Mont-de-Marsan, ne ressemble aucunement à celle-là. Elle est accidentée, ouverte au vent, labourée par les hommes, baignée par des ruisseaux sans nombre. Plus de grandes plantations de pin, mais beaucoup de petits bois de chênes ; plus de sable, mais une terre argileuse et forte. Le maïs y pousse bien, et sert de support à des taillis de haricots. Le blé et la vigne se mêlent sur les collines. Les vallées, surtout celles de l'Adour, ont de belles prairies vertes, et dans les chemins, au lieu des mules de la forêt, on rencontre le plus souvent des bœufs de trait, roux de pelage, dont le mufle est couvert d'un filet et la tête coiffée d'une peau de mouton qui couronne le joug.
L'habitation diffère aussi. Au lieu des chétives maisons de la forêt, on trouve des maisons spacieuses, carrées, bâties en pierre ordinairement, et surmontées d'un toit à deux pentes longues. Elles sont toutes orientées vers l'Est, à cause des vents de la mer. La distribution est presque partout identique : un grand hall central avec porte charretière, qui se nomme le sôou, – le sol, – une cuisine et deux ou trois chambre à droite, et l'étable à gauche, sous les mêmes tuiles que l'habitant. Entrez dans la maison, et vous serez aimablement accueilli. On vous offrira du "confit" d'oie, du lard salé, du vin du cru, et une tranche de méture, cet énorme pain de maïs, blanc humide, à peine levé, qui constitue le fond de la nourriture des landais de la Chalosse. Vous trouverez des gens d'humeur avenante, ayant presque tous une bonne instruction primaire, un peu roués dans les négociations, puisqu'ils sont paysans, mais d'une honnêteté supérieure à la moyenne dans l'exécution de la parole donnée. Quelques-uns sont fermiers ; la plupart sont métayers, prenant pour leur part les trois cinquièmes des céréales et la moitié du vin, parfois la moitié seulement de toutes choses. Chez eux, la propagande socialiste a très peu pénétré. Ils épargnent, sauf à se montrer quelquefois naïfs dans les placements. On prétend même que certains d'entre eux, affectant un goût vif pour la morue de Bordeaux, fixent les noces de leur fille un jour maigre, afin de faire moins de dépense, les salaisons n'étant pas chères.
En général aussi, ils entretiennent d'assez bonnes relations avec le propriétaire, qui les reçoit à sa table au premier de l'an, époque où sont acquittées les redevances en poulets, oies, canards. Ils sont religieux et vont volontiers en pèlerinage, par paroisses, au sanctuaire de Buglosse, patrie de saint Vincent de Paul, à dix kilomètres de Dax. Ils sont surtout imbus d'un très fort esprit de famille, et, mieux que d'autres, ont conservé plusieurs coutumes originales du passé. Voici pourquoi.

Si vous parcourez plusieurs cantons de cette province du sud-ouest, vous serez frappé de voir que le pays est un pays de petite culture, où les métairies, composées de quelques hectares seulement, semblent avoir été taillées pour suffire exactement aux besoins d'une famille, et qui portent toutes, à leur centre, la maison que j'ai décrite. Il résulte de là que la population est extrêmement disséminée, que les bourgs se réduisent souvent à une église, une mairie, un presbytère et une auberge, et que les habitants, soustraits aux influences de l'économie politique nouvelle, demeurent plus fidèles aux traditions locales.
Je ne veux pas parler de cette coutume si répandue encore dans tout le midi de la France, d'attribuer à un enfant, qu'on appelle l'herté ou l'hertère, un avantage du quart, ou du tiers si l'on peut, dans les biens paternels. Il y a d'autres usages, plus curieux et plus rares. J'en dirai un seulement.
Aux environs de Dax, et dans une partie des cantons de Peyrehorade et de Pouillon, il est assez commun de rencontrer, dans les contrats de mariage, une stipulation établissant une association de travail et une communauté entre le père, la mère et le jeune ménage qui vient s'établir sur la métairie. Si le fils a gagné quelque chose, par son travail, avant de se marier, il versera ses économies entre les mains du père. Sa jeune femme ne lui remettra pas sa dot, elle la remettra au père également, qui est le chef de l'association et le gérant responsable de la fortune des deux ménages. Si l'un des associés meurt, la communauté doit continuer entre les survivants. J'ai feuilleté un acte de cette espèce, dont les conséquences, paraît-il, avaient été heureuses, et j'y ai relevé une joli chose encore, le nom donné à lépouse d'un fils, qu'on désigne d'un mot latin : l'adventice.
Reste la troisième portion des Landes : le Marensin. C'est la forêt basse, coupée d'étangs et bordée par la mer. J'avais le désir de la traverser, et je partis de Dax pour Vieux-Boucau, l'ancienne bouche de l'Adour.
On y va d'abord, sur la ligne d'Espagne, jusqu'à Saint-Vincent-de-Tyrosse, puis on prend un petit chemin de fer départemental, qui mène à Soustons. Une voiture m'attendait là, et je continuai à travers les pins.
Presque au sortir du bourg de Soustons, dans la direction de la mer, on aperçoit l'étang, très long, qui dort, immobile, entre deux rives différemment plantées. À droite, il s'étend sur une plaine presque rase, tantôt repoussé par l'éperon d'un banc de bruyères, tantôt plongeant, au contraire, à travers les végétations basses, et reconnaissable encore aux rayons pâles de ses eaux, que hachent des touffes de joncs. L'autre bord est une lisière de futaie noire, dont les fûts sont doublés par le reflet du lac, et qui paraît, – ce n'est qu'une illusion, – une barrière infranchissable et une digue contre les crues. Le chemin que je suis tourne la pointe, et longe bientôt le très simple déversoir de cette masse énorme d'eau, le courant. Malgré son nom, le courant ne court guère. Mais il est clair, il arrose des prés en pente, il donne envie de pousser à des pommiers en exil, il est le prétexte qu'ont pris plusieurs maisons aux toits roses pour se poser là, sur la crête, avec des volées de canards et des troupeaux de vaches. C'est un joli coin. Puis le courant nous quitte. Je suis de nouveau dans la grande forêt sombre, frémissante sous le vent qui souffle de la côte. Elle est belle aussi parce qu'elle se prête difficilement à l'exploitation, et que les arbres y sont vieux. Des chênes-lièges se mêlent aux pins. Ils dominent bientôt. Ils se dressent de partout, bossués, couronnés de feuilles d'un vert gris, et bruns de tronc jusqu'aux premières branches, d'un brun pourpre de bois écorcé, qui donne un ton superbe aux profondeurs montantes des futaies. Tout cela chante sans trêve, les pins et les lièges ensemble, sans fausse note. Il y a de ces pays où il faut écouter autant que voir. Et j'écoute. Et le chemin s'allongeant toujours, le souvenir me revient d'une chanson d'Isidore Salles, le poète aimé des Landais, qui s'en allait ainsi, mesurant les lieues gasconnes.
|
||
|